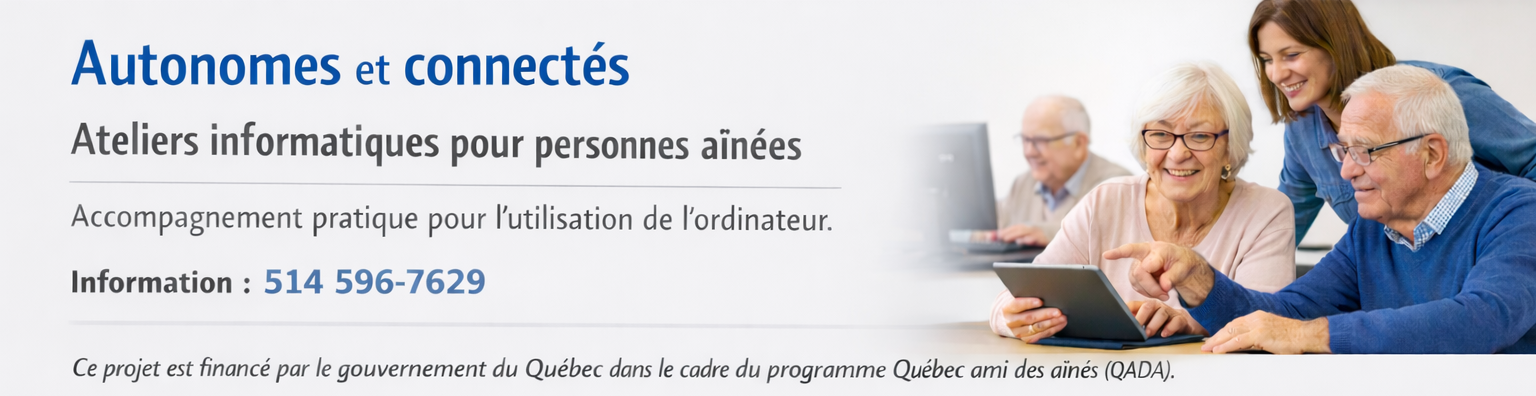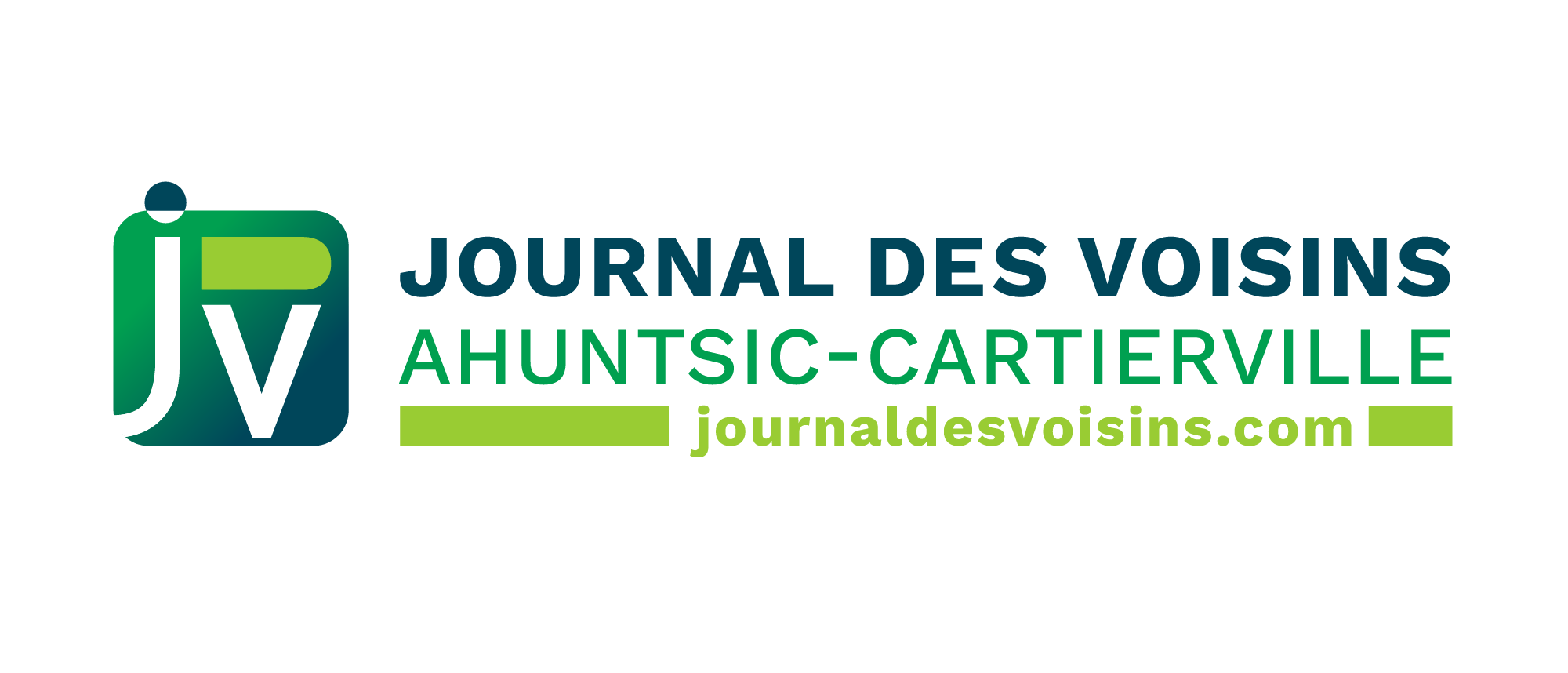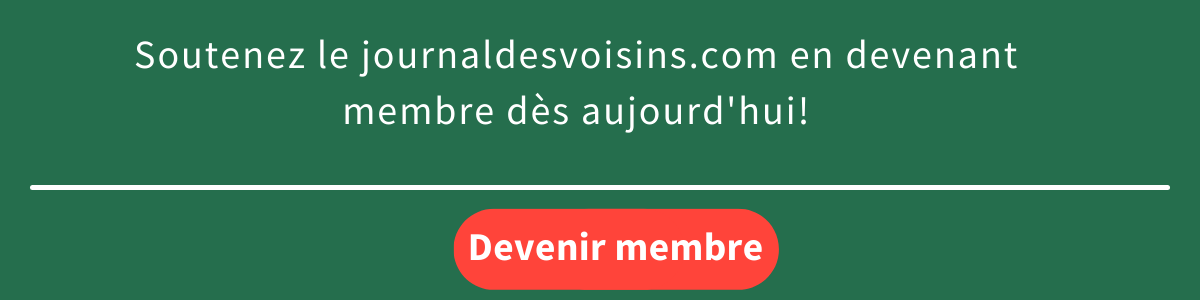Les fouilles réalisées sur le site de Fort-Lorette dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville intéressent plusieurs citoyens qui ont eu la possibilité d’en apprendre davantage le 17 juin dernier. L’objectif de cette rencontre était de présenter les résultats détaillés des fouilles archéologiques réalisées sur le site de Fort-Lorette en septembre 2024.
Justine Bourguignon-Tétreault, archéologue chargée de projet de la firme Arkéos a donné la conférence. En plus de découvrir les résultats des travaux, nous avons eu la possibilité de voir plusieurs des artéfacts récoltés sur le site.
Que s’est-il passé sur le site ?
Les derniers mois de Justine ont été faits de la prise en compte des découvertes effectuées en septembre 2024 et de la lecture des résultats des travaux précédents pour obtenir une meilleure compréhension du cadre bâti du site du fort, devenu par la suite un domaine seigneurial sur le terrain appartenant à la Fabrique de la paroisse de la Visitation. L’évolution de l’occupation de ce territoire permet une compréhension plus fine de la séquence des événements. Les travaux ont permis de relever plus de cultures matérielles, ainsi que des artéfacts qui s’ajoutent à la collection. Cela représente environ le double de ce qu’on avait à ce jour.
On a entendu dire qu’on avait trouvé des ossements sur le site. Justine précise que la grande majorité d’entre eux sont des ossements d’animaux issus d’activités de chasse, de pêche, de plantation et d’élevage qui donnent des informations intéressantes.
Les acquis majeurs de l’intervention
« On a vu l’intérêt de ressortir la collection des interventions précédentes pour avoir la chance de voir l’ensemble des objets, ce qui nous a permis de prendre des photos de la collection complète – ce qui complémente la vision que l’on avait déjà », nous dit l’archéologue.
Fort-Lorette a été associé à une mission sulpicienne dès 1696. Jusqu’à la fin du 17e siècle, il n’y a pas eu beaucoup d’autres occupations. En 1721, la mission ferme. Le terrain est conservé par les sulpiciens, qui sont aussi des seigneurs de l’Île de Montréal et qui en font leur domaine seigneurial. Ils vont réutiliser certaines des installations de l’ancien fort pour les activités de gestion du domaine. La maison seigneuriale va s’installer dans l’ancienne maison des missionnaires. « Il y a une réutilisation des structures en place que l’on comprenait plus ou moins bien archéologiquement parlant, » indique Justine.
Selon l’archéologue, les interventions de cette année et les aires de fouilles agrandies permettront d’avoir une vision plus détaillée des vestiges associés à l’occupation de la mission, lesquels ont été remplacés au moment de l’occupation par le domaine seigneurial.
La suite
Les trois inventaires archéologiques qui existent ont permis d’ouvrir des petites fenêtres isolées les unes des autres dans le grand espace du site pour en tirer une meilleure compréhension générale. Justine nous explique que les travaux de cette année ont permis d’ajouter des petits morceaux au casse-tête. « Au stade où l’on est rendu, ajoute-t-elle, nos recommandations pour la suite seront de relier ces fenêtres entre elles. L’intervention sera une fouille archéologique, donc plus ciblée, dans un ou deux secteurs du site. Cela consistera à ouvrir une plus grande superficie pour une fouille horizontale plutôt que de descendre en colonne verticale dans des endroits plus restreints. Ça donnera l’occasion de relier des structures que l’on pense liées les unes aux autres, mais pour lesquelles nous n’avons pas encore de preuve. »
L’objectif est d’approfondir les connaissances dans des secteurs très ciblés qui ont livré de l’information sur ces occupations plus anciennes au 18e siècle et qui sont mal connues.
L’hypothèse présentée par l’archéologue lors de la conférence pour la suite des recherches a porté sur le positionnement du village associé de 400 habitants dont aucune trace n’a jamais été trouvée.
Une version de cet article a été publié dans la version papier du JDV de juin 2025.
Restez informé
en vous abonnant à notre infolettre
Vous appréciez cette publication du Journal des voisins? Nous avons besoin de vous pour continuer à produire de l’information indépendante de qualité et d’intérêt public. Toute adhésion faite au Journal des voisins donne droit à un reçu fiscal.
Nous recueillons des données pour alimenter nos bases de données. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à notre politique de confidentialité.
Tout commentaire sera le bienvenu et publié sous réserve de modération basée sur la Nétiquette du JDV.