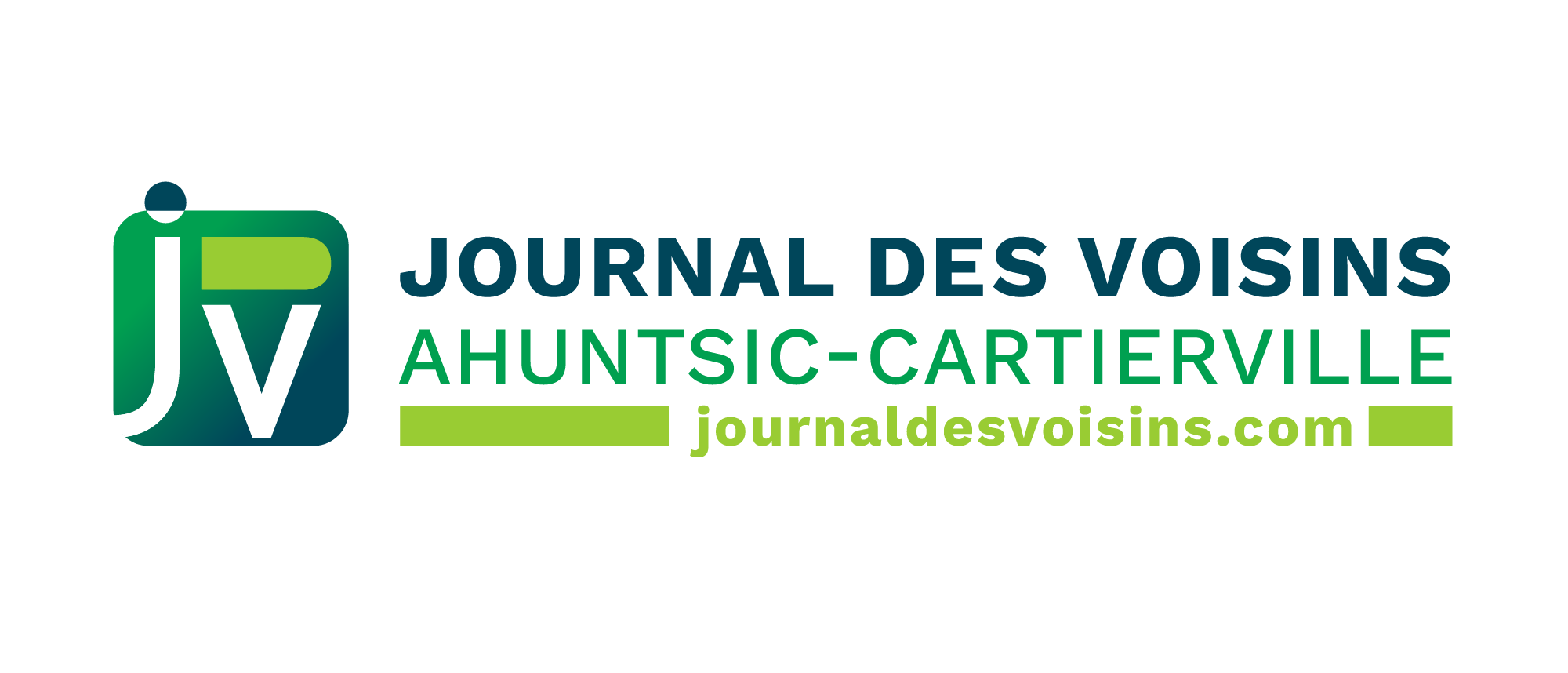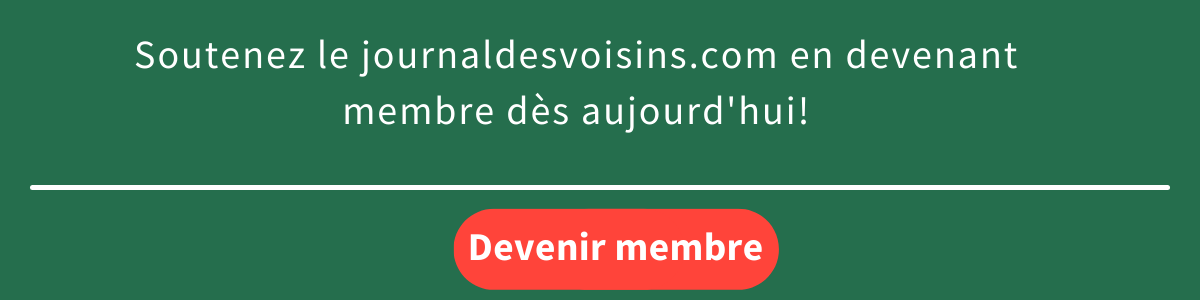Les enjeux concernant l’emploi sont différents pour chacun des types d’entreprises, mais on retrouve quand même quelques points communs dont le plus important est certainement les conséquences que la pandémie a eues sur le travail.
Voici les témoignages de trois entrepreneurs d’Ahuntsic-Cartierville qui ont accepté de se livrer au JDV.
Gabriel Tupula
PDG et fondateur de Big Bang, Gabriel Tupula nous reçoit dans ses bureaux, qui sont… presque vides. « Les employés ne viennent au bureau que le lundi et le jeudi. C’est maintenant la norme de travailler de chez soi. »
Big Bang est une entreprise de service-conseil en transformation numérique basée à Montréal avec des employés en Europe et en Afrique. « Les entreprises comme la nôtre font partie des industries les plus métamorphosées depuis la pandémie. La façon d’assurer la prestation de services s’est dématérialisée, explique M. Tupula. Personne n’a gagné la bataille du retour au bureau. On réduit l’espace, on met en place des politiques de travail flexibles pour qui vient au bureau, mais en fin de compte, c’est l’employé qui décide. »
Gabriel ajoute : « Je suis un adepte de l’apprentissage par exposition. Ça donne des bénéfices concrets qui ne pourront jamais être remplacés par la technologie disponible. »
La volatilité, un enjeu de taille
Selon M. Tupula, il y a une très haute volatilité de la main-d’œuvre depuis la pandémie, mais ça commence à se stabiliser. Et d’ajouter : « Quand les gens s’en vont après deux ans, ça finit par essouffler les organisations de petite taille comme la mienne. Engager, former et maintenir une entreprise ne se fera jamais plus comme avant ; aujourd’hui, il faut le faire à distance, et c’est très difficile de mobiliser les gens. C’est plus coûteux en temps, en énergie et en argent. C’est très lourd pour les gestionnaires. »
Et l’intelligence artificielle dans tout ça ?
« L’IA rend plusieurs postes d’entrée de gamme moins pertinents, soit des postes pour lesquels on embauchait quelqu’un d’inexpérimenté, nous dit Gabriel. Je me mets dans la peau de quelqu’un qui est entré à l’université en 2020, qui a obtenu son diplôme en 2023 et qui doit se faire une place dans l’industrie. Sans expérience du marché du travail, ça n’a pas l’air évident pour eux. »
Les changements inévitables
Reconfigurer le bureau pour qu’il ait l’air d’un café ou d’un pub, des journées obligatoires en présentiel, des activités de consolidation d’équipe, des 5 à 7, des dîners-conférences, une vision et des valeurs fortes, rien de tout cela n’est une réponse satisfaisante pour ramener les gens au bureau et les fidéliser. Les entreprises ont le fardeau de créer des raisons pour que les employés viennent au bureau.
« C’est une partie de la réponse, dit le PDG, mais ça répond très minimalement aux enjeux de fidélisation. Les liens tissés prépandémie restent forts. La relation est déjà bâtie. Avant d’arriver au même sentiment d’appartenance, c’est aujourd’hui beaucoup plus long lorsqu’on engage. »
En conclusion, Gabriel nous dit qu’il n’a pas la réponse sur ce qu’il faut faire : « Le monde a changé, je m’adapte. Tout ce qu’on a connu comme réalité n’existe plus. Le changement devient la norme. »
Philippe Gagnon
Fondée en 1980, Attraction est une entreprise familiale de Lac Drolet, en Estrie, spécialisée dans la conception, la fabrication et l’identification de vêtements promotionnels, et elle a vécu en temps de pandémie des difficultés de recrutement. En un an, elle a perdu une vingtaine d’employés qui sont partis travailler, entre autres, dans le réseau de la santé.
Vice-président, opérations canadiennes, M. Gagnon nous raconte que la pandémie a obligé l’entreprise à changer son fusil d’épaule et à délocaliser une partie de la production pour se rapprocher de la main-d’œuvre. La coupe et la couture sont maintenant faites à Montréal.
Le recrutement
Les produits d’Attraction demandent une main-d’œuvre spécialisée qui peut au besoin être formée sur place si elle n’a pas d’expérience. « Dans notre domaine, sur Chabanel, dit Philippe, les gens ne vont pas sur les réseaux comme LinkedIn pour trouver du travail ; ils font le tour des entreprises et y déposent leur CV. Notre bonne réputation nous aide à recruter, et nos employés de production sont tous syndiqués. Notre plus gros enjeu tient aux départs à la retraite. Ce ne sont pas des métiers à la mode. La main-d’œuvre disponible est plus âgée, et nous sommes conscients que les gens auront une vie de travail moins longue. »
Gagnon affirme que c’est la raison pour laquelle l’entreprise s’est tournée vers les nouveaux arrivants. Ceux qui ont autour de la cinquantaine ne veulent pas nécessairement retourner aux études, et ils vont souvent vers des emplois d’entrée. Le profil type de ces employés est qu’ils ont peu de scolarité ou une scolarité non reconnue.
« Pour trouver ces employés, il faut être vu, présent dans les salons ou en contact avec les OBNL en francisation et intégration, précise Philippe. Nous avons par exemple accueilli une classe de francisation en entreprise dans le cadre d’un programme du gouvernement, et les employés qui le désiraient ont reçu 80 heures de cours sur 16 semaines. »
L’achat local, une bonne affaire
« Actuellement, conclut M. Gagnon, le climat est difficile, mais comme l’entreprise est 100 % canadienne et que nos clients sont à 98 % canadiens, nous surfons un peu sur la vague de soutien à l’achat local. »
Robert Herrera
Propriétaire du groupe Les Cavistes, Robert Herrera est au cœur de la problématique du recrutement de main-d’œuvre. « C’est clairement beaucoup plus difficile depuis la pandémie, nous dit-il. Pendant les deux années de peu ou pas d’activité, les gens ont trouvé d’autres emplois. Ceux de nos employés qui avaient entre 21 et 27 ans avaient la chance de faire une formation pour pallier le manque d’emploi dans notre secteur d’activité. Et c’est maintenant la génération montante ouverte aux postes d’entrée qui mènent normalement à une carrière après deux ou trois ans qui se fait rare. »
« Quand on est revenu à temps plein, explique Robert, on était en manque d’employés. On a dû se tourner vers l’immigration. En 2022-23, on a accueilli huit ou neuf personnes de l’étranger. Il faut compter environ 6000 $ par personne pour la faire venir, régulariser ses papiers et favoriser son intégration. Ça crée des augmentations de coûts de fonctionnement en plus des salaires, et cela entraîne une diminution de la marge de profit, qui n’est déjà pas très élevée. »
Herrera affirme par ailleurs que le taux de rétention des étrangers recrutés est d’environ 60 %. Les raisons vont de l’ennui de la famille à l’incapacité de s’adapter à notre mode de vie, à quoi s’ajoutent des erreurs administratives, mais aussi des lois difficiles à appliquer ou propres à empêcher la reconduction des permis.
Depuis le 26 septembre 2024, certaines demandes d’évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT) présentées pour des postes à bas salaires (salaires inférieurs à 37 $ de l’heure dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) – Montréal et Laval –, qui ont un taux de chômage de 6 % et plus, ne sont pas traitées par le gouvernement canadien. Cela a pour effet d’empêcher certains travailleurs de rester au-delà de leur contrat de deux ans. Des mesures seront aussi émises par le gouvernement du Québec pour réduire l’accès aux travailleurs étrangers.
« Nous avons deux employés qui veulent rester, qui parlent français, qui sont intégrés et qui sont très heureux de travailler ici, souligne M. Herrera. Il faut dire que les conditions de travail en restauration au Québec sont bien meilleures qu’en Europe. On se fait parfois dire que ce sont des emplois mal payés ; 50 000 $ par année, ce n’est pas le Klondike, mais pour des jeunes en début de carrière, ce n’est pas si mal, et ils créent une activité économique dans le quartier où ils vivent. Il faut des emplois dans toutes les tranches de salaire. On ne peut pas payer un salaire de 50 $ de l’heure. [Comme clients,] vous trouveriez que le steak coûte cher à 60 $ ! »
L’homme d’affaires rappelle pour finir qu’on risque toujours un peu de devoir repartir à zéro, ce qui augmente les coûts en stress. Ces coûts ne sont pas perceptibles, mais ils n’en ont pas moins un impact sur la longévité d’un travailleur et le moral d’une équipe.
Cet article a été publié dans la version papier du JDV de juin 2025.
Restez informé
en vous abonnant à notre infolettre
Vous appréciez cette publication du Journal des voisins? Nous avons besoin de vous pour continuer à produire de l’information indépendante de qualité et d’intérêt public. Toute adhésion faite au Journal des voisins donne droit à un reçu fiscal.
Nous recueillons des données pour alimenter nos bases de données. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à notre politique de confidentialité.
Tout commentaire sera le bienvenu et publié sous réserve de modération basée sur la Nétiquette du JDV.