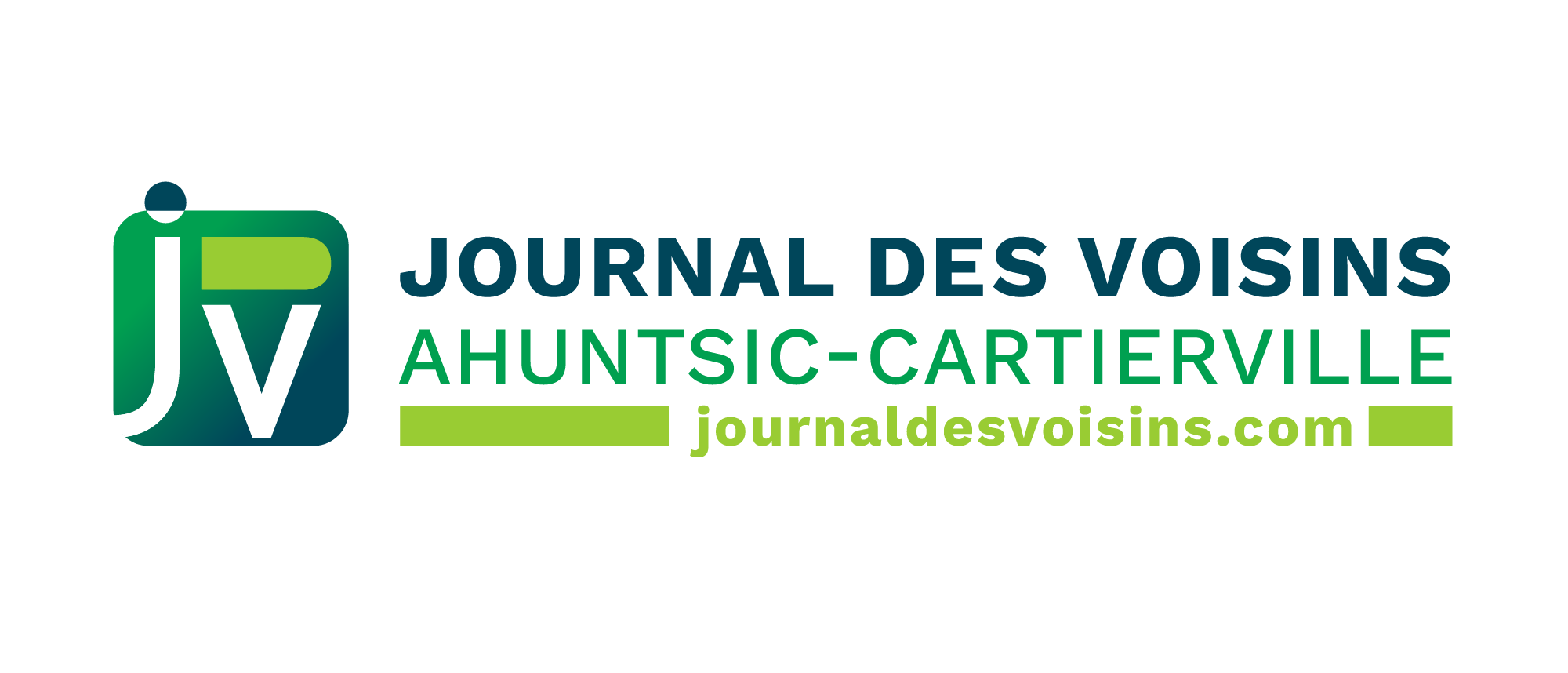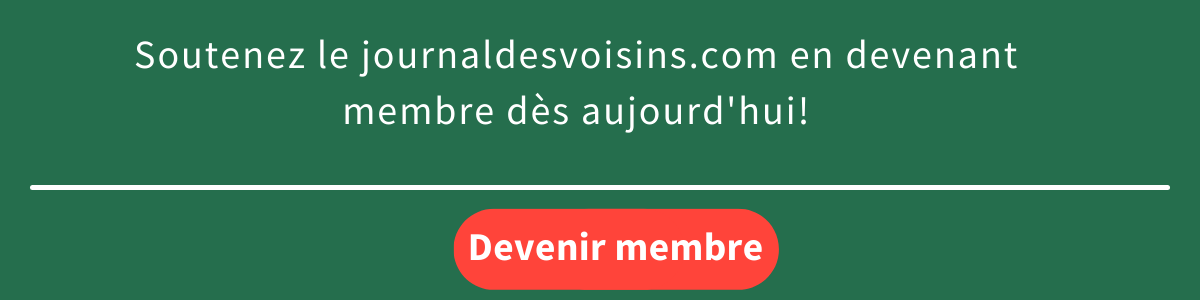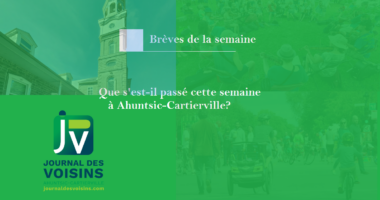Des événements violents survenus à Bordeaux-Cartierville ont souligné la fragilité du sentiment de sécurité chez les citoyens. Au-delà de l’enquête judiciaire, la police ne peut pas faire de la psychologie, mais elle doit malgré tout rassurer une population qui craint la perte de sa quiétude.
Le 29 avril, vers 11 h, la rue Drouart, à Bordeaux, est le théâtre d’une fusillade. Des coups de feu sont tirés sur un logement. Le lendemain soir, une violation de domicile est signalée dans la même rue.
La police arrête rapidement un jeune de 16 ans qui avait vidé un chargeur. Elle met aussi la main au collet de l’un des assaillants du domicile peu de temps après les événements.
Le commandant du poste de police de quartier (PDQ) 10, Yanik Laneville, affirme qu’il est crucial de mener une enquête sur le terrain pour appréhender les criminels et apaiser les craintes des résidents. « Il y a là quelque chose d’émotif qui est difficile à comprendre, et nous n’avons pas vraiment la réponse psychologique à cela », confie M. Laneville en entrevue avec le Journal des voisins (JDV).
Toutefois, les policiers ne restent pas les bras croisés. Juste après les faits, le chef du PDQ 10 souligne, dans une infolettre adressée aux différents partenaires locaux, la nécessité d’agir pour rassurer les citoyens. Les patrouilleurs sont déployés, font du porte-à-porte, parlent aux gens. Tout le monde veut voir les policiers et recevoir des explications sur ce qui se passe.
Comment rassurer ?
« Nous ne sommes pas habitués à voir ça, et c’est un fait que la violence armée s’est rapprochée de nous », observe M. Laneville. Des armes que des jeunes peuvent se procurer facilement, et qui servent à envoyer des messages entre maffieux, notamment.
« Travailler sur le sentiment de sécurité est excessivement difficile », admet le commandant, tout en précisant qu’il n’en déploie pas moins des efforts en ce sens à travers la présence policière, le porte-à-porte, la rationalisation de la situation et les comparaisons avec d’autres grandes villes.
Un épisode de violence fait les manchettes et marque durablement les esprits. « Ce qu’en disent les médias, c’est qu’un grave épisode de violence armée a eu lieu dans le quartier, et le lendemain, ils n’en parlent déjà plus.» Mais le sentiment de sécurité est perturbé. L’inquiétude s’installe. Et la perception de sa propre sécurité diffère d’une personne à une autre.
« Les gens se parlent beaucoup. C’est souvent une même histoire qui circule, mais les gens pensent qu’il s’agit d’événements différents », observe le policier, pour qui, au-delà du trouble que peut provoquer un événement violent, il importe d’appréhender la situation de manière globale, que ce soit à Bordeaux-Cartierville ou ailleurs sur l’Île-de-Montréal.
« Nos plus proches comparables, ce sont nos voisins du Sud. En prenant des indicateurs simples, on peut connaître le nombre d’homicides dans une année ; un paramètre assez général pour voir comment évolue la criminalité partout sur la planète », souligne M. Laneville.
Il cite la ville de Philadelphie, comparable à Montréal par le nombre d’habitants : « À Philadelphie, avec une population de 1,7 million de personnes, ils sont à plus de 500 homicides par année, donc un et demi par jour. Nous [à Montréal] sommes entre 30 et 35 [par an]. »
Ces chiffres démontrent année après année que Montréal demeure tout de même une ville sécuritaire.
Peur de l’inconnu
Ce ne sont pas seulement des événements violents inattendus qui perturbent la tranquillité des citoyens. Ce sont aussi des situations qui ne présentent pas a priori de danger pour le public qui inquiètent.
« On vit la même chose présentement avec le phénomène de l’itinérance », assure M. Laneville. Il rappelle toutefois que ce sont les personnes en situation d’itinérance qui sont éminemment vulnérables, et non celles qui passent à côté d’un itinérant.
« L’espérance de vie d’une personne en situation d’itinérance par rapport aux autres doit être de l’ordre de 25 ans de moins », estime le chef du PDQ 10, qui mentionne au passage la crise du fentanyl, qui touche essentiellement des personnes très vulnérables.
« [Ici encore,] les gens ont cette crainte de ne pas savoir, le sentiment que quelque chose ne va pas, mais sans savoir ce que c’est. Ils se sentent atteints par ça », conclut le policier.
Cet article a été publié dans la version papier du JDV de juin 2025.
Restez informé
en vous abonnant à notre infolettre
Vous appréciez cette publication du Journal des voisins? Nous avons besoin de vous pour continuer à produire de l’information indépendante de qualité et d’intérêt public. Toute adhésion faite au Journal des voisins donne droit à un reçu fiscal.
Nous recueillons des données pour alimenter nos bases de données. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à notre politique de confidentialité.
Tout commentaire sera le bienvenu et publié sous réserve de modération basée sur la Nétiquette du JDV.