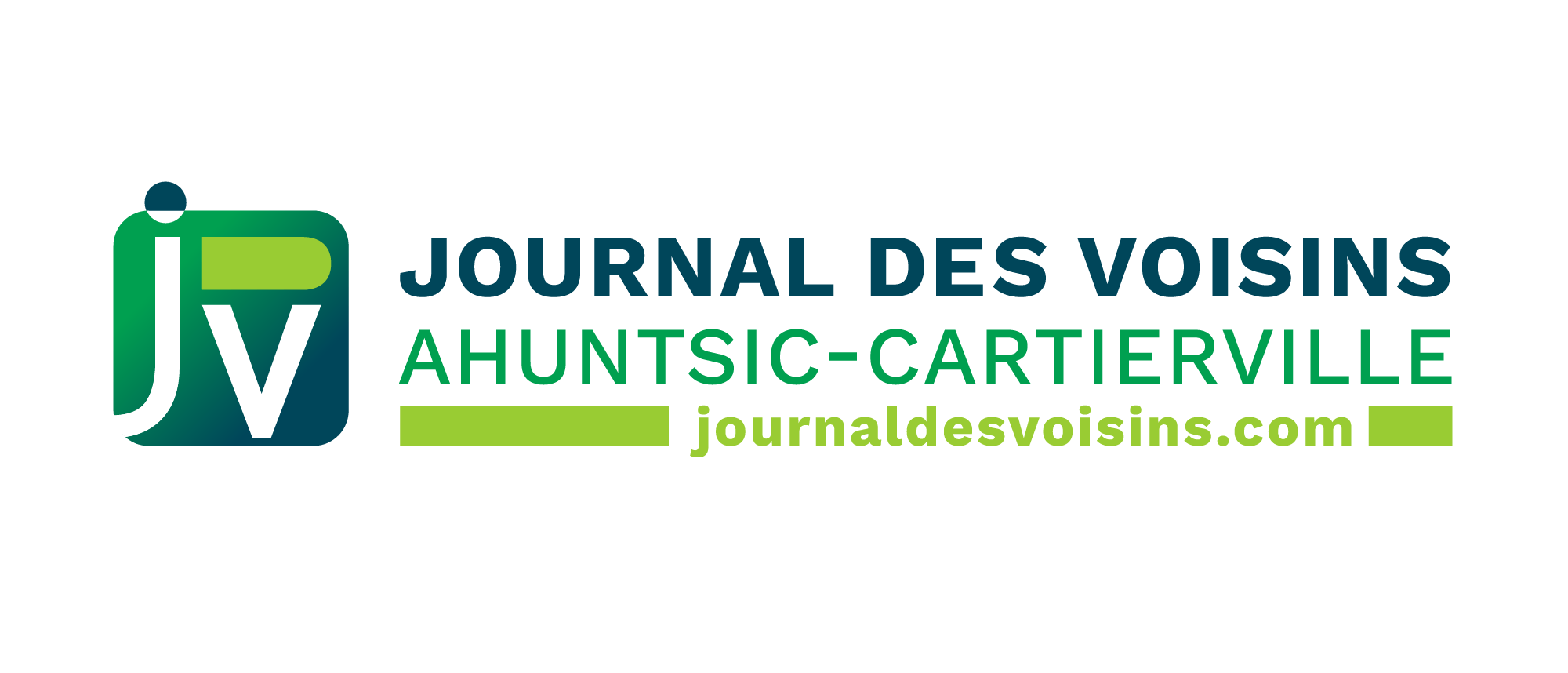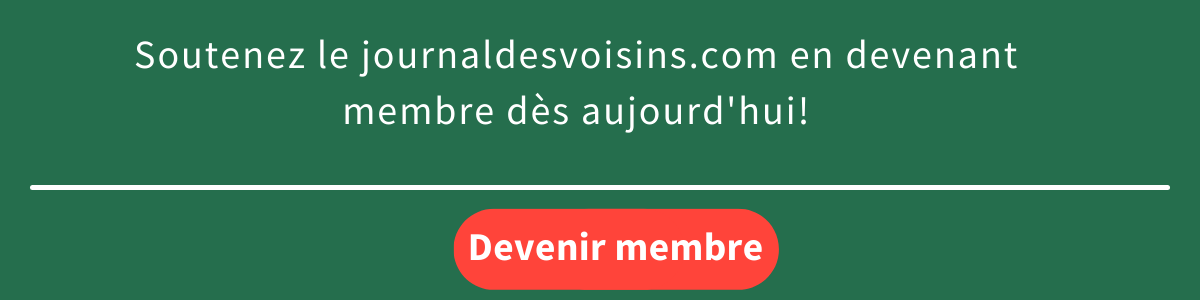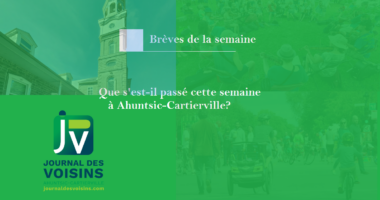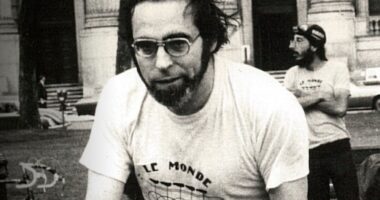Visite surprise dans ma cour à la mi-avril : deux Tourterelles tristes sont venues picorer les graines de tournesol tombées de ma mangeoire. Bien que je l’entende ou l’aperçoive régulièrement lors de promenades dans le quartier, il y avait un certain temps que je ne n’avais vu cet oiseau chez moi. Et pourtant, le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec indique que leur nombre serait en augmentation et leur aire, en extension.
Elle tient son nom, tant en français qu’en anglais, de son chant plaintif « Couaahouu-houu-houu-houu », qu’elle répète très souvent au printemps et en été. Le mâle se perche en évidence pour chanter et attirer une compagne, ce qui rend l’observation de ce colombidé assez facile, sauf évidemment dans un arbre au feuillage touffu.
Description
Son plumage est une élégante succession de dégradés subtils. Un corps effilé avec une tête et un dos gris-beige, les ailes grisâtres avec des points noirs et dont les rémiges primaires sont noires lisérées de blanc, une poitrine et des flancs beiges lavés de rose, et une longue queue pointue. On note aussi un point noir de chaque côté du bas de la tête.
En vol, on entend le sifflement produit par ses battements d’ailes et on aperçoit des bordures blanches aux extrémités des plumes de sa queue en fer de lance.
Les deux sexes sont identiques et les juvéniles sont d’une coloration brunâtre avec des marbrures sur les ailes.
Habitat et territoire
La Tourterelle triste semble à l’aise dans une grande variété d’habitats tant agricoles qu’urbains ; vergers, petits boisés, bosquets, jardins et parcs sont des endroits où on est susceptible de la trouver.
Elle niche de l’Amérique centrale, incluant certaines grandes îles des Antilles, jusqu’au sud du Canada. Au Québec, on la retrouve surtout dans les plaines du Saint-Laurent et de l’Outaouais, et dans la partie habitée du Saguenay–Lac-Saint-Jean. On mentionne aussi des observations sur la Côte-Nord, en Gaspésie, à Anticosti et en Abitibi-Témiscamingue.
Nidification
Tant le mâle que la femelle participent à la confection du nid. Celui-ci est une construction plutôt rudimentaire de brindilles et d’herbes installée à la fourche ou sur une branche d’un grand arbre. Il est plutôt fragile et peut donc être facilement détruit par un fort vent ou une tempête estivale, projetant les œufs (ou les oisillons) au sol.
La femelle pond généralement deux œufs, qui sont couvés tour à tour par les deux membres du couple. Lors de cette période, le mâle défend un territoire autour du nid en chantant et en chassant les autres tourterelles.
L’alimentation des oisillons se fait au début par régurgitation d’une purée de graines prédigérées qu’on nomme « lait de pigeon ». Plus tard, les parents y ajoutent progressivement des graines qu’ils picorent au sol. Une fois les oisillons assez développés, les Tourterelles se regroupent pour se déplacer et s’alimenter.
Migration et tendances
En hiver, la Tourterelle triste se retire des régions les plus nordiques de son habitat, soit le sud du Canada et certains États du nord des É.-U. pour y revenir en mars ou avril. Par contre, on a souvent vu des individus passer la saison froide parmi nous, ce qui n’est pas sans danger pour eux. En effet, des périodes prolongées de grand froid ont causé des engelures aux doigts de pied de ces oiseaux moins bien équipés que nos résidents habituels pour y résister.
La présence de cet oiseau dans la région montréalaise n’a été confirmée que dans les années 1920. Le nombre de nicheurs s’y est fortement accru durant les années 1960 à 1990, sans doute une conséquence de l’intensification de l’agriculture et de l’urbanisation. La présence de mangeoires est aussi un facteur contributif.
Espèces cousines
On a déjà fait mention, il y a quelques années, de la présence exceptionnelle, dans le sud du Québec, de la Tourterelle à ailes blanches, espèce que l’on retrouve habituellement dans la partie sud des É.-U.
Il en va de même pour la Tourterelle turque (ou à collier), une espèce eurasienne dont on a rapporté une nidification en Montérégie.
Cet article a été publié dans la versin papier du JDV de juin 2025.
Restez informé
en vous abonnant à notre infolettre
Vous appréciez cette publication du Journal des voisins? Nous avons besoin de vous pour continuer à produire de l’information indépendante de qualité et d’intérêt public. Toute adhésion faite au Journal des voisins donne droit à un reçu fiscal.
Nous recueillons des données pour alimenter nos bases de données. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à notre politique de confidentialité.
Tout commentaire sera le bienvenu et publié sous réserve de modération basée sur la Nétiquette du JDV.